Le simple passant

Il y a longtemps que je ne t’ai vue. Je passe chaque matin sous ta fenêtre au persiennes fermées. J’aimerai te voir accoudée au balcon de fer. Comme avant. Mais tu n’es pas là, tu as disparu. Quand ? Je ne sais plus. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je t’ai vue. Les souvenirs se mélangent. Je confonds les dates, les mois, les années, ta place dans ce fatras du passé qui s’encombre, m’encombre. Il n’y a plus que cette fenêtre qui me rattache à ton passé. Elle est désespérément fermée, sombre, triste avec ses sculptures qui la distinguent de tant d’autres. Elle te ressemble un peu. Tu étais différente, particulière, c’est pour cela que je t’ai remarquée. Mais aujourd’hui, je ne trouve plus de vraies raisons à cette fugace passion. Il reste l’habitude de passer devant ta fenêtre chaque matin. La fidélité d’un chien à un maître qui l’a abandonné ? Non, je n’en suis pas là. Pourtant, parfois, je m’en sens si proche. Stupide, cela me ressemble plus. Je le serais encore plus si les persiennes étaient ouvertes un matin en passant devant elles. J’ai pris l’habitude de les voir fermées. Un confort, une aisance à ma timidité. Oui, j’aurais dû t’aborder, te parler avant que tu ne disparaisses. Mais, je n’ai rien fait de cela. Je t’ai regardée de loin avant de baisser la tête en passant proche de toi. C’est ma nature. Elle ne changera pas. Je sais que si un jour tu reviens, que tu t’installes au balcon, je passerais sous ta fenêtre en restant ce simple passant dont tu n’as aucun souvenir.
Lire la suiteLe pont interdit

Je pourrais te conter l’histoire de ce palais illuminé, de son prince solitaire. Pour te faire comprendre, je te dirais qu’il y a dans une ville lointaine, franchissant un fleuve aux eaux froides et sombres, un pont interdit. A son entrée veillent deux lions de pierre aux yeux fermés. Couchés de chaque côté de la chaussée, ils semblent paisibles mais leurs yeux de pierre parfois se soulèvent laissant apparaître des pupilles jaunes et cruelles. Jamais tu ne me croiras car dans ton monde les sculptures ne bougent pas, ne parlent pas, ne vivent pas. Pourtant, dans cette ville, le monde est si différent. Ta réalité n’existe pas. Les lions de pierre sont aussi redoutables que ceux que tu visites au zoo. Là, dans cette ville, de l’autre côté du fleuve s’étend sur la colline un palais qui s’illumine chaque soir. Peu de personnes l’ont visité. Ceux qui s’y sont introduits n’en sont jamais revenus. Les rumeurs les plus folles courent sur ce pont, ses gardiens, ce prince qui se désolerait de sa solitude.
Je te sens attentive. Mon histoire t’aurait-elle éveillée à cette nouvelle réalité ? Ferme les yeux. Imagine. Une nuit noire et chaude. Entends-tu le silence pesant de ce fleuve qui coule à tes pieds ? Tu aimes sa fraîcheur. Elle te fait du bien. Tu as envie d’ouvrir les yeux, de voir ce château que ton imagination vient de dessiner. Tu voudrais savoir si la réalité est conforme à ce que tu ressens. N’oublie pas qu’il doit être immense, vivement éclairé, aux larges fenêtres avec de hautes colonnes. Trace à ses pieds, un pont qui le relie à toi. Tu y es presque. Je le sens. Vas-y ouvre les yeux, entre dans ce monde nouveau pour toi. Le château est bien comme tu l’as imaginé, le fleuve aussi, le pont; tout est en place. Il ne te reste plus qu’à franchir le fleuve, courir vers le palais, rejoindre le prince. Je sais que son nom t’a appelée. La simple évocation d’une hypothétique rencontre a eu effet de ta raison. Monter vers le château est un risque que tu veux courir maintenant. Souviens-toi des lions aux yeux fermés. Ce rappel ne te fait pas peur. Je ne te comprends plus.
Le jeu me dépasse. Je te racontais ces histoires pour t’amuser, te distraire. J’ai inventé cela par inadvertance, gratuitement, stupidement. Tu m’as cru. Trop. Comment te retenir ? Le jour va se lever, les lumières s’éteindre. Le pont, le château vont perdre de leur éclat. Tu l’as compris. Maintenant, tu cours vers le pont, t’engage entre les lions aux yeux fermés. Je cours après toi pour te retenir. Et, si mon histoire était vraie ? Je ne sais plus. Reviens ! Je t’en supplie. J’ai peur pour toi, pour nous.
Tu as pris de l’avance sur moi. Juste assez pour que mes mains ne puissent pas s’agripper à toi pour te freiner, t’arrêter. Tu es passée entre les lions de pierre. Je suis soulagé. Mon histoire n’était qu’une chimère. Si, tu savais le bien que cela me fait de m’en rendre compte ! Un instant, j’ai eu la sensation que tout était si vrai. Tu cours maintenant sur le pont, vers le palais illuminé. Je sais que je te reverrai. Cela me rassure. Ta silhouette s’amenuise dans le lointain. Ta foulée est rapide, plus que la mienne. Je suis essoufflé. A l’est, le jour soulève un coin de nuit. Dans le ciel se dessine le voile blanc d’un matin de brume. Je m’arrête à l’entrée du pont pour en profiter, pour me reposer. Jamais, je n’irai plus loin. Les yeux, jaunes et cruels des lions de pierre, me regardent à l’entrée du pont interdit.
Lire la suiteLes angelots jouaient dans le ciel

De l’autre côté de la rue, les fenêtres de la grande maison grises sont fermées par des volets de métal blanc. Des murs gris, une rambarde de fer noire. Elles ne s’ouvrent jamais. La journée, l’animation de la rue, les voitures, les piétons passent devant sans la moindre attention.
Gris, tristes, les murs de cette grande maison sont impersonnels. Elle ressemble à tant d’autres habitations de la rue. Pourtant, un jour, un homme seul est venu y habiter. Il parlait au vent, à la lune, murmurait des choses incompréhensibles. Son pas traînant, était hésitant, comme celui d’un enfant qui a trop vite grandi. Son visage, vieux, avait quelque chose d’enfantin. Ses yeux, malicieux, facétieux, n’étaient pas à leur place sur ce visage ridé.
Avec l’arrivée de la nuit, les lueurs des réverbères, le silence de la lune, des angelots au travers des volets de métal blanc s’échappaient, volant dans le ciel. Pour les voir, il fallait ouvrir son cœur aux mystères de la nuit, entendre leurs cris, leur joie de s’échapper. Quand, dans la grande maison de l’autre côté de la rue, la maternité a fermé, posé ses volets blancs sur ses fenêtres, plongeant les chambres dans un noir profond, les angelots se sont sentis délaissés.
C’est ce jour où l’homme est arrivé.
Il a replié les volets d’une fenêtre, ouvert un œil à la grande maison. Chaque soir, une lumière s’est allumée au plafond d’une cuisine. L’homme mangeait seul, assis à une table, faisant de grands gestes. Dans l’ancienne maternité, les enfants, sans parents, couraient dans les couloirs de la maison. Morts, ils ne faisaient pas de bruit mais le souffle de leurs courses perturbait l’homme prenant son repas. Il se levait, éteignait la lumière, plongeant la grande maison dans l’obscurité
C’était le moment où les réverbères s’allumaient dans la rue.
Au travers des volets, les angelots s’échappaient, se poursuivant dans le ciel, dans la grande récréation de la nuit. Sur les pavés de la chaussée, des chats passaient d’un pas nonchalant, regardant les gamins du ciel se poursuivre. Dans l’église, toute proche, les angelots jouaient à cache-cache derrière les grands piliers de pierres rouges ; appuyaient sur le clavier de l’orgue. La musique montait dans la voute de l’église, réveillant les gens. Chaque soir, c’était ainsi.
C’était le moment où l’homme sortait dans la rue.
Il faisait peur, grommelant, crachant au sol, marchant péniblement, s’appuyant sur sa canne. Il se dirigeait vers l’église, regardant le clocher, hurlant des paroles incompréhensibles. L’orgue s’arrêtait. Le silence revenait. Dans la rue, ses pouvoirs étranges ont fait naître la terreur. Sa maison est devenue celle de la peur. Les gens se sont détournés, évitant de passer devant, paniquant. L’homme l’a ressenti.
C’est le moment où il a décidé de fermer la seule fenêtre ouverte.
La maison grise est maintenant fermée. Les volets de métal blancs sont clos. Il n’y a plus de lumière le soir dans la cuisine. Certains soirs d’orage, les habitants de la rue disent entendre des cris de pleurs d’enfants sortant de la grande maison. Ils sont chargés de détresse, d’abandon. Plus personne n’est là pour les garder.
Lire la suite
Le banc des amoureux

Il n’y a que les amoureux, sur les bancs publics, qui ont le droit d’être heureux. Langoureux, ils savent que les neiges éternelles protègent leur amour. Regarde leurs yeux, cette étincelle de jeunesse, leur folie, leur vie. Nous étions ainsi. Aujourd’hui, nous marchons moins vite avec nos corps usés. Le banc nous permet de nous reposer. On ne croit plus aux neiges éternelles. Mais nous sommes toujours assis ensemble sur ce banc public où les amoureux ont le droit d’être heureux. Ce n’est pas une performance mais cette volonté de chaque jour qui a protégé notre amour. Alors, oui, je le confesse, je suis un menteur, je crois encore aux neiges éternelles bien que l’existence m’ait enseigné qu’elles fondent au soleil. J’ai su tourner le regard pour ne pas être tenté par d’autres mirages. J’ai conservé les yeux ouverts, rivés sur toi, cherchant à m’éclairer de ta vie, de ta folie. Elles m’ont protégé, me conduisant vers ce banc où je prends toujours autant de plaisir à être assis en ta compagnie. Prochainement, nous ne pourrons plus y venir. Les forces nous manqueront. Ce n’est pas les neiges de l’amour qui fondent au soleil mais la vie, nos vies. Ne le dis pas aux amoureux, ne brise pas leurs rêves. Nous étions si bien lorsque nous avions leur âge, que nous faisions ce projet fou de ne jamais nous quitter. Nous l’avons tenu.
Lire la suitePourquoi-as-tu fait ce vœu ?

On était si bien au bord de cette rivière. Il faisait chaud. L’ombre des saules, la fraîcheur de l’eau nous rafraîchissaient. Nous étions si bien. Je sais, je me répète. Mais comment ne pas le faire ? Ta main jouait avec l’herbe. J’aimais la regarder avec ses doigts blancs tressant des brins d’herbe que tu lançais dans l’eau. J’ai eu cette idée folle. Oui, je m’en veux. Je m’en voudrai toujours, c’est l’unique certitude qui m’habitera maintenant. Je t’ai dit que tu ne pouvais pas lancer à l’eau la tresse d’herbe sans faire un vœu. Tu m’as regardé, amusée avec dans les yeux cet éclat espiègle qui te caractérisait. Tu te souviens ? Quelle question stupide ? Tu as fait le vœu. Celui de rester jeune, belle à jamais. « Comme les poupées de mon enfance », as-tu ajouté. Cela m’a fait sourire car ta déclaration était forte, authentique, chargée de plein d’espoirs. La tresse d’herbe est tombée dans l’eau, le courant l’emportant, sans que nous n’y prêtions attention. La nuit est arrivée. Nous sommes rentrés. Tu étais fatiguée, détendue. Nous venions de passer une belle journée. Ce fut la dernière. Je vis dans le rêve de ce moment passé. Depuis, j’ai jeté tant de tresses d’herbe dans l’eau de la rivière. J’ai remonté son cours maintes fois à la recherche de ce nœud où le temps s’est tordu pour modifier ta vie, notre vie. Je marche encore vers ce lieu que je désespère de trouver. Tu m’accompagnes bien que tu ne sois plus là en ma compagnie. Tu es toujours dans mon esprit. Seul, je sais que ma quête sera longue, parfois je m’effondre devant mon impuissance mais il faut que je lutte pour toi, pour nous. Je dois trouver le lieu où les choses ont été modifiées. Il y va de ma survie devant tes yeux fixes, tes mains tendues avec leur raideur immobile, incapables d’attraper le vide qui se tend à elles. Souvent, si souvent, toujours, je m’accuse de t’avoir demandé de faire ce vœu stupide. Pourquoi as-tu souhaité être transformée en la poupée de ton enfance ? Quel plaisir as-tu espéré trouver ? Regarde ce que tu es devenue ! Croiser ton regard est un supplice. Ton absence figée est une abomination. Le pire est que tu continues à sourire. Je n’ose croire que dans ta prison de plastic, tu trouves encore assez d’espace pour avoir des sentiments ou la foi dans un vœu qui t’amènerait à changer de statue, d’attitude ? Tu es là, posée sur un meuble, comme un objet dont on retire parfois la poussière. Tu pourrais tout aussi bien être au fond d’un placard, cela ne changerait en rien ton attitude. Il m’arrive parfois d’avoir cette idée folle de te jeter à la rivière, de me débarrasser de ton encombrante présence. Ce qui me retient ? Cette espérance que tu as encore un cœur, une âme, toutes ces choses qui te différencient de la poupée de ton enfance. Je sais, c’est absurde. Ton vœu ne m’a laissé qu’une absurdité pour dernière trace de ton amour.
Lire la suiteLettre d’amour
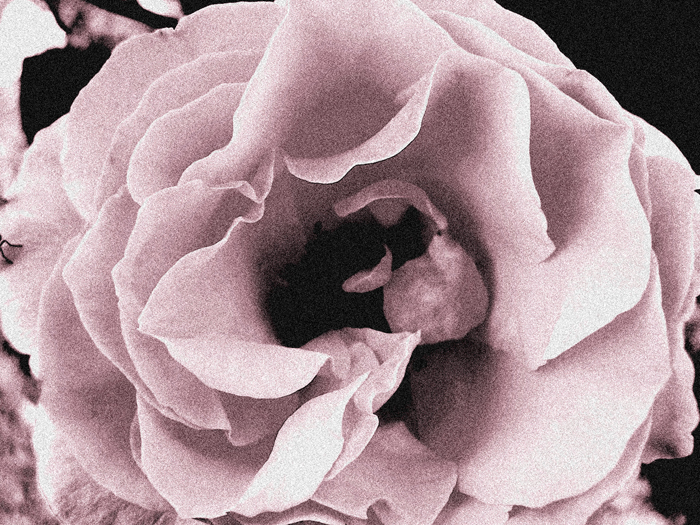
Lettre d’amour
Je pourrais t’écrire que je t’aime, que tu me manques, parler de fleurs, d’absence, tous ces mots maintes fois trimbalés au fil des lettres ; si souvent utilisés qu’ils en perdent tous leurs sens.
Ne les-as-tu pas employés par le passé, venant progressivement se faner dans le vase étroit d’une vie étouffée?
Au moment de la séparation, tu les avais oubliés.
Aurais-tu retrouvé ces lettres enflammées, que tu les aurais déchirées.
Te souviens-tu ?
Il écrivait si bien, savait te toucher d’un adjectif choisi, d’une comparaison flatteuse. Tu étais si facile à conquérir alors que ce matin, tu as un regard de chien au souvenir de cette rupture venue lessiver l’encre des belles lettres du passé.
Aussi, moi le nouveau qui frappe à la porte de ton cœur, je ne vais pas te dire que je t’aime, ni te raconter des mensonges rapidement recopiés sur des pages froides, préfabriquées, prédigérées.
Ce serait si facile, si malhonnête, si loin de ma vérité.
Tu n’y croirais pas.
Tu aurais raison.
Les promesses, les envolées, tout cela est dépassé.
Cela appartient à une époque où tout était neuf. Nous ne le sommes plus, ni l’un, ni l’autre. S’en rendre compte, n’est-ce pas le moyen de trouver la force pour reconstruire une vie ?
Aussi, pourquoi te parler de certitudes alors que nous avons d’abord à nous faire confiance ?
Le temps sera le témoin de notre passion, le seul juge. Franchir ensemble les étapes qu’il nous présentera est un défi que je veux relever en ta compagnie.
Alors, reçois simplement ces quelques mots pour savoir que j’ai pensé à toi.












